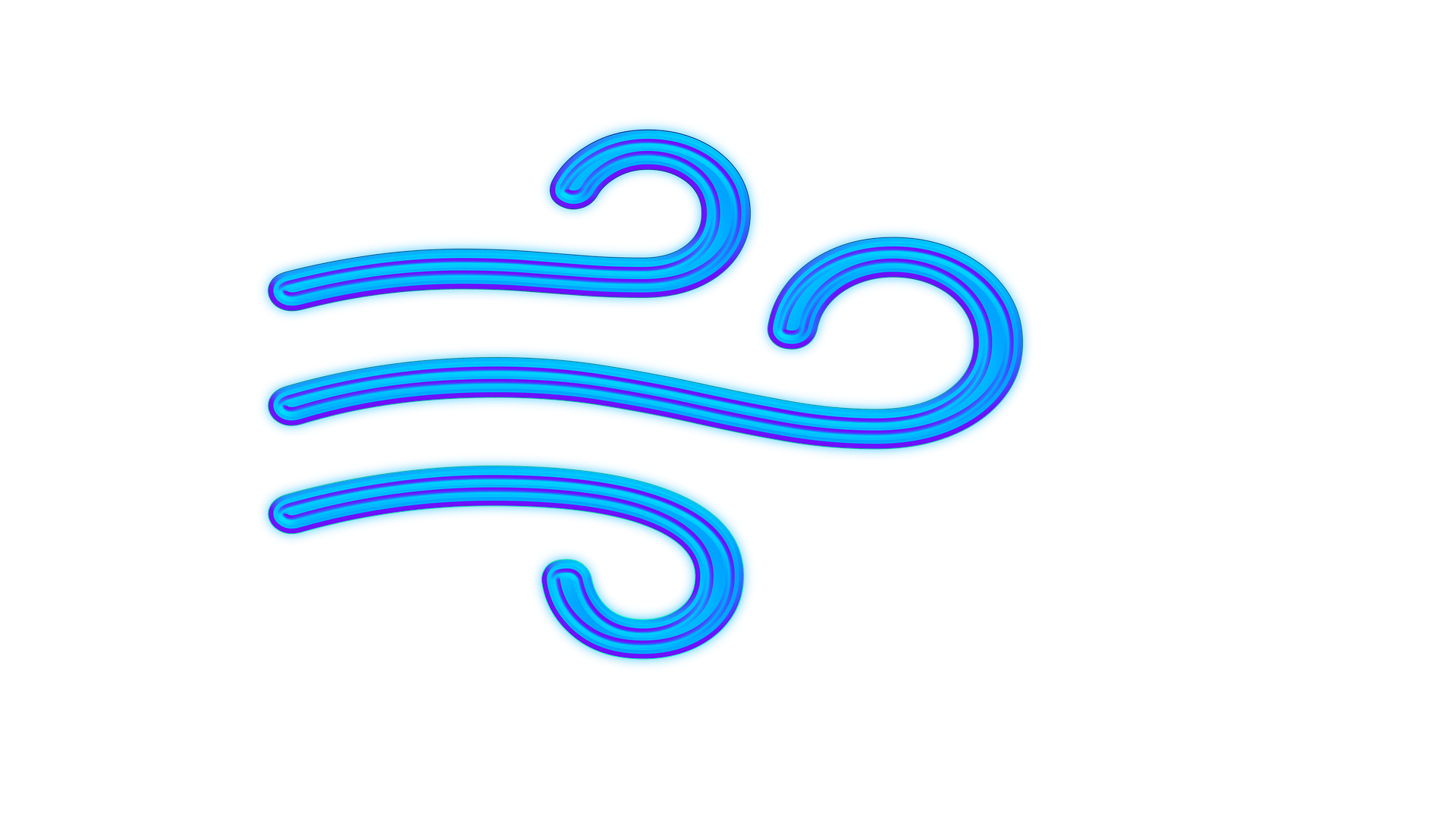Philip, prince consort
Le 18 avril 2021.
Au-delà d’un moment d’Histoire pour nous observateurs, la mort du prince Philip, Duc d’Edimbourg, est probablement aussi un déchirement pour la reine Elizabeth. Avec plus de soixante-treize ans de mariage, ils avaient célébré leurs noces de platine et auraient célébré celles d’albâtre dans un an et demi ! A cet égard, l’image de la reine assise seule dans la chapelle Saint George m’interpella, à l’aune de mes modestes trente-trois années d’union officielle : comment vit-on l’absence de celui qui vous accompagna si longtemps ? Vaste question, que je garde pour l'instant dans un recoin de mon esprit.
Dans le cas précis de la reine et de son époux, elle l'aima certainement, il l'aima tout aussi certainement et l'accompagna évidemment. Il fut son mari, son compagnon, l’homme dans l’ombre de son épouse, son prince consort.
Cette réflexion sur ces trois quarts de siècles vécus en commun et sur ces destins quasi-asymptotiques (dans leurs fonctions en tous cas) m’amena, comme souvent, à plonger dans mes chers dictionnaires.
Mon Robert historique de la langue française nous explique que le consort, emprunté au latin consors, « partage le même sort ». L’emploi le plus vivant est celui qui traduit (1669) l’anglais Queen-consort « époux de la reine ». Le terme de prince consort s’applique à l’époux non couronné d’un souverain régnant d’où, par métaphore, à l’époux d’une femme possédant une renommée supérieure à la sienne.
Le Nouveau Larousse illustré de 1946, nous rappelle, quant à lui, que le mari de la Reine Victoria ne possédait aucun titre honorifique anglais et n’occupait à la cour d’autre rang que celui qu’on lui laissait par courtoisie. En 1857, le titre de prince-consort lui fut octroyé par lettres patentes.
Le consort anglais (XVIIe/XVIIIe siècles) peut aussi représenter un ensemble instrumental. En témoigne The Royal consort, six suites de danses du compositeur William Lawes (1602-1645, reconnu comme un des plus grands maîtres de cette spécialité anglaise qu'est la musique de consort), dont le disque 33T est conservé dans les remarquables réserves de notre Bibliothèque municipale Louis Nucera.
Dans le langage courant, l’expression « et consorts » signifie « et compagnie », alors que dans le champ juridique elle désigne collectivement les personnes qui, dans un contrat ou dans une décision de justice, ont un intérêt commun. En l’occurrence, Elizabeth et Philip avaient bien un double intérêt commun : leur couple et la Couronne, même si, sur le second, il ne fut que son second (dans le cas présent, le qualifier d’éternel serait péjoratif et désormais faux…)
Intéressant aussi, ce terme de second, issu du latin secundus, celui qui suit. Secundus s’est d’abord dit du courant que descend la barque, du vent qui la pousse ; s’opposant à adversus, il a signifié « qui va dans le même sens », d’où « favorable » puis « qui vient après ». Le prince Philip allait évidemment dans le même sens que sa reine, mais il venait après elle. De même, il était bien second, mais non deuxième, puisqu’il n’y avait nul troisième. Comme dans une charade, la reine aurait donc pu dire de lui : « Mon second », comme d’autres disent : « Mon précieux », expression qu’elle aurait pu faire sienne aussi, vraisemblablement.
Enfin, Marguerite Yourcenar, dans les Mémoires d’Hadrien, explique que « César avait raison de préférer la première place dans un village à la seconde à Rome. Non par ambition ou par vaine gloire, mais parce que l'homme placé en second n'a le choix qu'entre les dangers de l'obéissance, ceux de la révolte, et ceux, plus graves, du compromis. » Shocking, isn’t it ? Le Royaume-Uni n’étant toutefois pas un village de seconde main, rendons au Duc d’Edimbourg que, sans être César, il tint son rang (le second) et he never blew a fuse *.
Indeed !
* To blow a fuse : péter un fusible